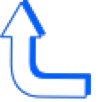Atelier de forgeron de l’époque (mais pas celui de Joseph Blouin)
Une histoire d’Antoinette*
Oyez, oyez, jeunes et vieux de la famille, je vais vous raconter l’histoire véritable, belle mais triste, de ma très jolie tante Antoinette.
C’était il y a très longtemps, en 1915, au siècle dernier. Née le 4 décembre 1892, tante Antoinette était âgée de 22 ans lorsqu’elle a été victime d’un grave accident ans à Montréal, au coin des rue Saint-Hubert et Ontario.
La maison où elle est née, dans le rang 5 de Saint-Lazare-de-Bellechasse, existe toujours. Elle est aujourd’hui la propriété de son arrière-petit neveu, Charles-Henri Chabot, fils de Maurice, fils d’Alphée, fils de Pierre. Ce dernier épousa Aurélie Bilodeau, la fille d’André Bilodeau, un marchand du village, le 20 octobre 1879. Ils s’établirent d’abord à Saint-Magloire, un village nouvellement fondé. Ils revinrent à Saint-Lazare vers 1886, au moment du décès subit du père d’Aurélie.
Antoinette était la huitième d’une famille qui devait compter 16 enfants, lorsque le dernier né, Albert, est né en 1906. Quatre d’entre eux étaient décédés entre 1899 et 1904, au moment où toute la famille était partie s’établir aux États-Unis, à Somersworth dans le New Hamshire. Le couple croyait ainsi offrir aux enfants une vie meilleure dans les filatures de coton. Ludivine et Albertine y trouvèrent un emploi dès qu’elles eurent atteint l’âge requis, soit douze ans. Elles furent emportées par la consomption un an plus tard. Joseph, l’aîné de la famille, fut frappé du même mal et s’éteignit à 22 ans. Quant à la petite Léontine, 3 ans, elle contracta probablement la même maladie qui la terrassa. Alors âgée d’une dizaine d’années, Antoinette avait été témoin de tous ces décès et du terrible chagrin de ses parents et des autres membres de la famille. C’est Aurélie qui, inconsolable, prit la décision de revenir au Québec, sur leur ferme, sans tarder. Malgré tous ces malheurs, la jeune Antoinette avait eu l’occasion, à l’école et surtout au contact de compagnes de jeu, d’apprendre l’anglais.
Au retour, elle n’eut d’autre choix que de participer aux travaux de la ferme, d’assister sa vaillante mère et de s’occuper de ses frères plus jeunes. Mais les garçons en âge de donner un coup de main n’avaient qu’une idée, partir gagner leur vie ailleurs. Ils avaient trop vu leurs parents peiner comme des forçats sur une terre de roches. Mais l’argent manquait toujours. Et il fallait que chacun et chacune fasse sa part. Aussi, la jeune Antoinette était bien souvent forcée d’apporter un peu de soutien à son père, déjà usé, passé la cinquantaine, par le travail forcené, les déboires et les contrariétés qui avaient parsemé son existence.
Ainsi quand elle eut 16 ans, elle commença à faire des projets pour partir en ville et trouver un travail. Dans la région avoisinante, il n’était pas possible de trouver le moindre emploi permettant de gagner sa vie dignement et librement. Aurélie, à qui elle avait confié son souhait, se souvint d’une cousine qui habitait Montréal. Celle-ci voulut bien accueillir cette nièce que sa mère lui avait dépeinte comme débrouillarde et vaillante. Ainsi, au printemps de l’année 1911, alors qu’elle avait atteint 18 ans, son père la conduisit à Saint-Charles où elle prit le train pour cette nouvelle aventure.
La veuve Moreau, une dame âgée, se félicita d’avoir accueilli cette jeune fille pimpante, primesautière, dynamique. Elle fut toutefois un peu déçue lorsque celle-ci lui annonça son désir de trouver le plutôt possible un emploi. Mais elle comprenait cette hâte et l’approuvait au fond. Elle n’eut pas de difficulté à trouver une place de domestique. Puis ses patrons, un notaire et son épouse, ayant noté son aisance à distraire, amuser et même instruire les enfants, n’hésitèrent pas à lui confier souvent la garde de leurs deux jeunes marmots.
À l’été 1913, une annonce parue dans La Presse attira son attention. Le grand magasin Dupuis Frères recherchait une vendeuse attrayante et dynamique pour son rayon de lingerie féminine. La candidate devait avoir de l’expérience, mais Antoinette se dit qu’il ne coûtait rien de tenter sa chance. Le travail domestique et la garde d’enfant commençaient à lui peser. Le monsieur qui la reçut ne parut pas d’abord intéressé par sa candidature. Attrayante, ça elle l’était, mais jeune, trop jeune. Toutefois, son aisance à répondre à ses questions, sa vivacité d’esprit, son entregent, sa voix engageante, pleine d’affabilité, le convainquirent qu’il s’agissait là d’une perle rare. Deux jours plus tard elle trônait derrière le comptoir des dessous et des accessoires affriolants pour dames. Son succès, surtout auprès de ces messieurs cherchant un cadeau pour la dame de leur cœur, fut immédiat et formidable. Non seulement, était-elle jolie, toujours vêtue sobrement mais avec une élégance soignée, elle envoûtait littéralement sa clientèle avec sa voix chaude et rassurante, sa prestance, sa gentillesse, son port de princesse, en un mot sa beauté.
Elle apprit qu’il se nommait René-Richard ce monsieur chic qui l’avait interviewée. Mais les employés, surtout les jeunes femmes, le surnommaient Rich. En fait, il était l’un des directeurs du magasin. Elle le voyait souvent à l’étage qui l’observait, mine de rien. Elle en était un peu gênée, mais comprenait que c’était son rôle.
Quelque temps plus tard, l’ayant mandée à son bureau, il la félicita pour son travail impeccable et il l’invita à prendre un repas avec lui un soir prochain, à sa convenance. Interdite, elle ne sut lui répondre sur-le-champ. Quoique jeune et inexpérimentée, naïve même, elle comprenait que s’engager dans une relation avec un patron n’était pas sans risque. Elle le trouvait beau. Il était élégant. Sa moustache finement taillée, ses yeux narrons perçants, sa chevelure légèrement bouclée, lui donnaient une allure de prince. De plus il était certainement riche. Mais souhaitait-elle s‘aventurer dans une liaison qui serait une source de contrariétés, de tracas et de chagrins? D’un autre côté avait-elle le choix de le décevoir? Elle aimait son travail. Ses gages surpassaient, et de loin, ceux de ses emplois passés, surtout depuis la récente augmentation à laquelle elle avait eu droit. Ses aptitudes pour la vente étaient ainsi reconnues, mais elle comprenait maintenant que l’empressement de Monsieur était dicté par un autre motif.
Quelques jours plus tard, elle dînait avec lui dans un restaurant chic de l’ouest de la métropole. Elle s’attendait à ce qu’il lui fasse la cour. Elle ne s’était pas trompée. Mais il le fit avec élégance, délicatesse, retenue, en évitant de la heurter. Il ne lui cacha pas cependant que sa beauté, son esprit primesautier, son affabilité, sa gentillesse l’avaient frappé dès le jour de l’interview et que depuis il rêvait de la courtiser. Mais il respecterait son souhait et sa décision et elle n’avait pas à craindre quelque répercussion négative en cas de refus.
Antoinette savait, pour avoir entendu les cancans répandus par la gent féminine du magasin, que monsieur Rich était un gentil playboy, amateur de bonne chère, de bons vins, de voyages, sportif et adepte des courses hippiques et automobiles. Malgré cela, elle se laissa faire la cour et charmer par ses bonnes manières, sa galanterie, sa prévenance, ses attentions. Et bientôt elle répondit à ses avances et accepta de l’accompagner dans ses nombreuses sorties. Et puis, lorsqu’ils furent plus intimes, il loua un appartement non loin du magasin où ils pourraient consommer leur amour. À vrai dire, dès le début, cet homme lui avait plu et il n’en fallait pas davantage pour qu’elle en tombe amoureuse.
Contrairement à ses appréhensions, Rich lui était fidèle, la gâtant plus que de raison, l’entourant de tant de prévenances que cela la gênait. Il voulut même qu’elle quitte son emploi, mais elle refusa net, désirant conserver cette part de liberté qu’un travail lui assurait. Bien sûr, sa liaison avec un patron attisait les ragots, les commérages et la jalousie chez ses collègues de travail. Mais cela l’indifférait et elle se trouvait heureuse de son sort.
Jusqu’à ce soir fatal, alors qu’elle revenait de faire des courses, une voiture vint la happer sur le trottoir où elle déambulait vers son domicile, rue Saint-Hubert. Tel que le rapporta le journal La Presse, le spectacle était horrible. La voiture l’avait acculée contre un poteau, lui broyant la jambe droite et créant d’autres lésions dans la région du bassin. On la transporta d’abord.dans une pharmacie tout près où on lui prodigua les premiers soins. Puis on la conduisit à l’hôpital Notre-Dame, rue Sherbrooke, où les médecins durent prendre la terrible décision de lui amputer immédiatement la jambe réduite en charpie. Un moment son état fut considéré comme désespéré mais elle survécut, devant toutefois subir plus tard d’autres interventions qui eurent comme effet d’hypothéquer gravement sa longévité. Et dire qu’elle prévoyait quitter la ville deux semaines plus tard pour visiter sa famille à l’occasion de ses vacances annuelles.
Pendant plus de deux ans, Rich s’occupa d’elle, s’assurant qu’elle recevait les meilleurs soins à l’hôpital. Il intenta pour elle un procès en dommages qui lui rapporta une somme suffisante pour qu’elle puisse vivre sans avoir à se morfondre pour gagner son pain. Il fit aussi confectionner pour elle une prothèse assez sophistiquée pour lui permettre de se déplacer sans que son amputation soit trop apparente. Elle dut se montrer patiente et courageuse, car sa convalescence fut longue et que les exercices auxquels elle dut se soumettre pour recouvrer ses forces et s’habituer au port de sa prothèse, se révélèrent pénibles.
Et survint le jour où elle dut prendre la décision qu’elle mijotait depuis déjà un long moment. Elle en était venue à la conclusion qu’elle ne pouvait plus imposer à Rich, cet homme qu’elle aimait, sa condition de femme infirme. Ce n’était pas qu’il ait montré quelque dépit à ce sujet ou fait quelque remarque aigre-douce, au contraire. Il ne cessait, toujours empressé, de l’encourager et de pourvoir à tous ses besoins. Aussi trouvait-elle difficile de lui faire comprendre que le couple qu’ils formaient et qui devait bientôt, selon leurs vœux, être consacré officiellement, était devenu incongru et irréaliste.
C’est donc à l’été 1918, alors qu’il devenait de plus en plus certain que la maudite guerre allait enfin se terminer et qu’une maladie mortelle nommée Grippe espagnole éclosait en Europe et risquait de se propager en Amérique, qu’Antoinette fit part à Rich de sa ferme intention de quitter Montréal pour son village natal. Entre-temps, elle était revenue habiter son appartement où elle bénéficiait des soins d’une jeune religieuse infirmière serviable, Sœur Sainte-Aimée-des-Anges, qu’elle avait affublée du sobriquet de Bonne Sœur, ce qui la contrariait. De son côté, cette dernière se plaisait, pour la taquiner, à appeler Antoinette Petite Sœur. Grâce à l’intervention de Rich auprès de la Supérieure de sa Communauté religieuse, elle avait été à ses côtés, à l’hôpital, depuis le lendemain de son accident.
Mais la réaction qu’elle avait anticipée à l’annonce de son départ, ne se manifesta pas, à son grand étonnement et bonheur. Il y eut des larmes, mais partagées, l’un et l’autre comprenant que l’éloignement constituait la meilleure façon de conserver intact, sans tache, leur amour. Il n’avait duré que peu, mais n’avait été assombri, à vrai dire, que par un seul nuage, rouge, couleur du sang.
C’est Rich qui la conduisit au train et prit les mesures pour que le voyage lui soit facilité jusqu’à destination. À Saint-Charles un taxi l’attendait qui la conduisit chez son père. Elle eut droit à un accueil rempli d’émotions qui la conforta. Dès le lendemain, toutefois, elle prit possession de la petite maison que sa mère avait louée pour elle au village. Elle avait décidé de vivre seule et de façon autonome. Mais comme la nouvelle avait circulé depuis longtemps qu’elle était financièrement aisée, elle attira l’attention de nombreux jeunes courtisans à la recherche d’une compagne. Bien, sûr, son infirmité faisait réfléchir, mais cela ne semblait pas un frein, surtout que le bruit avait couru que son accident avait grandement compromis son espérance de vie.
C’est alors que son oncle Laurent, qui avait pris la relève de son père pour diriger la ferronnerie familiale, lui fit part de l’intérêt que lui portait un jeune homme de sa connaissance, un peu plus âgé qu’elle, dans la mi-trentaine, Joseph A. Blouin. Il était sérieux et assez aisé, ayant hérité de son père, Anselme, de la boutique de forge située au bas de la côte. Son apparence était quelconque, mais il était robuste, travailleur et réputé expert dans son métier. Maquignon, il conseillait les cultivateurs du canton qui souhaitaient se procurer un bon cheval de trait. Lui-même possédait un étalon et de jeunes pouliches qu’il se plaisait faire parader dans la paroisse. Il était sobre, honnête, et jouissait d’une réputation sans reproche. À défaut d’être un Beau Brummell, il lui ferait un compagnon constant, fidèle et attentionné.
Antoinette accepta donc sa demande en mariage qui eut lieu le 18 juin 1919 dans l’église paroissiale. Sa mère Aurélie s’était montrée un peu réticente à cette union. Avait-elle un motif d’être inquiète, de douter qu’elle ait été viciée par l’odeur de l’argent? Jusqu’à son décès, survenu le 6 mai 1923, à l’âge de 30 ans, il est notoire qu’elle fut traitée par son époux avec beaucoup d’égards. Il la dorlotait, l’entourait de petits soins. Presque tous les soirs d’été, lorsque la température était clémente, il faisait avec elle la tournée des rangs de la paroisse dans un tilbury tiré par l’une de ses fringantes juments. Pendant ces années, elle rendait souvent visite à ses parents vieillissants à la ferme familiale, même si en raison se son handicap, elle n’était plus en mesure de leur apporter son aide. Mais sa présence semblait les réconforter.
Elle passait du temps aussi chez sa sœur Joséphine, dont la santé s’était détériorée après plusieurs couches rapprochées. Elle s’occupait de ses jeunes enfants qui affectionnaient beaucoup cette gentille tante qui leur apportait des sucreries et n’oubliait pas le jour de leur anniversaire. Ils ne cessaient d’être médusés par cette jambe mécanique qui fonctionnait si bien. Mais cette sœur qu’elle chérissait devait quitter ce monde avant elle, le 21 novembre 1920, à 37 ans. Elle en fut dévastée et, pendant un certain temps, elle apporta aide et soutien à son mari, Wilfrid Couture, laissé veuf avec 7 enfants.
D’autres évènements avaient marqué sa venue à Saint-Lazare. Le mariage de son frère Alphée avec sa belle Eugénie le 9 juillet 1918, le seul parmi ses frères qui avait accepté de prendre la relève de son père, malgré son peu d’appétence pour le métier d’agriculteur. Il ne restait au foyer familial qu’Albert et Lauradan, ce dernier se mourant d’envie de prendre aussi la route des États dès que possible.
Elle n’était pas malheureuse, bien entourée par ses parents et ses proches, choyée par son époux, portée sur la main en raison de son aisance, estimée et respectée aussi pour sa gentillesse et sa simplicité. Quoique fragile, elle surmontait assez bien son infirmité, sa prothèse perfectionnée lui permettant de la rendre difficile à détecter. Sous ses robes amples, sa claudication était quasi imperceptible. C’est au début de l’année 1923 que sa santé commença à s’étioler. Rapidement ses forces déclinèrent, la médecine n’y pouvant rien. Les premiers merles s’égosillaient quand elle quitta le monde.
Marcel Chabot, avril 2021
* Notes : Au lecteur - Il s’agit d’un récit romancé (donc qui contient une part d’invention) reposant sur des faits réels, vérifiables, mais assaisonnés pour à la fois combler des zones obscures et expliquer la tournure de certains évènements autrement incompréhensibles. Pour dissiper toute ambiguïté, j’ai donc décidé de publier à part quelques documents (coupures de journaux) qui font un compte rendu des faits directement rattachés à l’accident et à ses conséquences.
Crédits : La plupart des photos sont tirées de la Banq, sauf celle de l’atelier du forgeron qui provient de l’Encyclopédie de l’Amérique française, et celle de la voiture Ford T 1915, prise dans Google Images, Mad4Wheels.
Marcel Chabot, avril 2021


Magasin Dupuis Frères
865, Ste-Catherine est,
Montréal
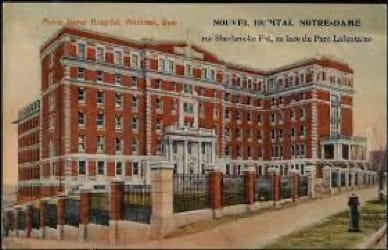

Ford T 1915, du type de celle qui a percuté Antoinette et broyé sa jambe
Hôpital Notre-Dame
Rue Sherbrooke, Montréal
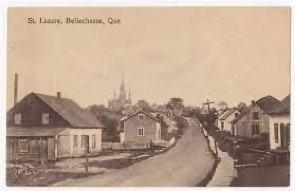
Saint-Lazare-de-Bellechasse
(Début du XXe siècle)

Mariage
Antoinette Chabot
Joseph Blouin